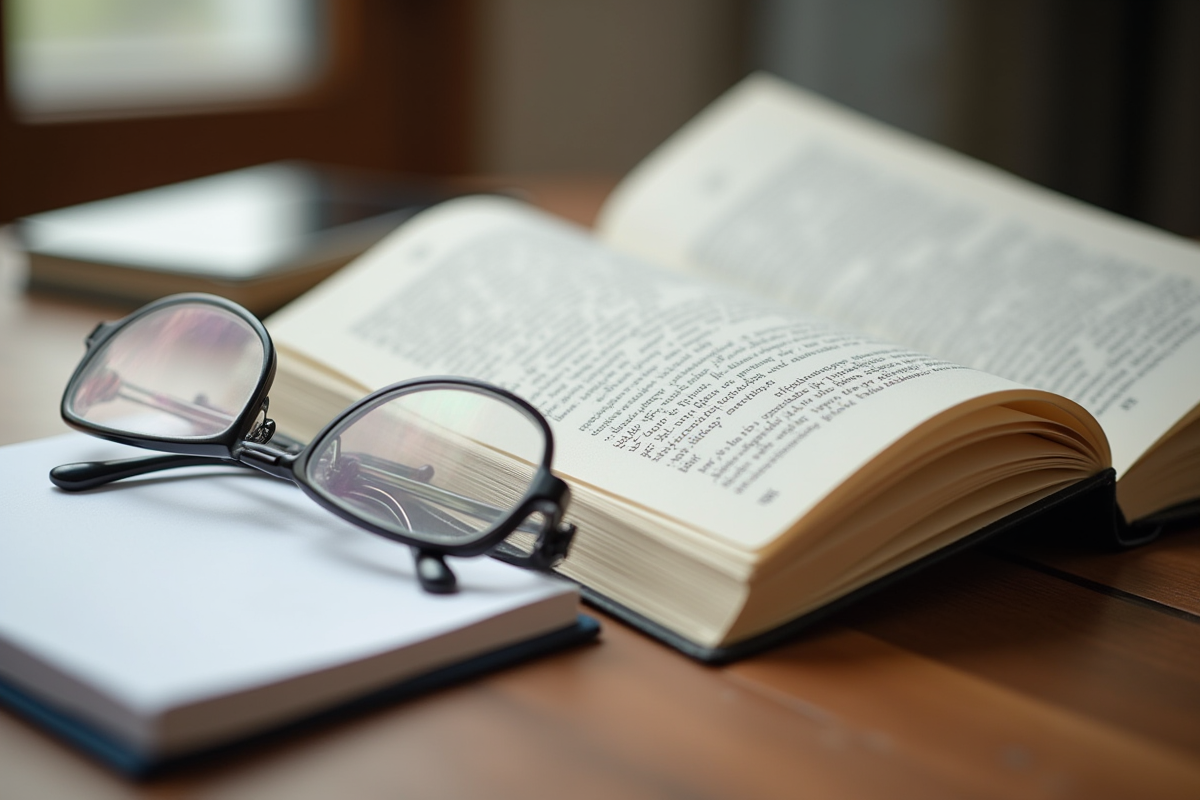Obtenir la preuve avant même d’engager un procès : ce qui relevait hier du parcours d’obstacles est désormais balisé par une série de décrets venus bouleverser les habitudes des praticiens. Sous l’effet des réformes récentes, l’article 145 du Code de procédure civile est devenu un laboratoire d’innovation procédurale, où chaque détail compte. Les professionnels du droit, quant à eux, naviguent dans un paysage où anticipation et précision sont les maîtres mots.
L’introduction des demandes nouvelles, encadrée par le décret du 6 mai 2017, a modifié les équilibres dans la conduite du procès civil. Les juridictions composent avec des conditions renouvelées et des délais resserrés, rendant la maîtrise des incidences réglementaires indispensable.
Article 145 CPC : un outil clé pour la recherche de preuve avant tout procès
Dans la panoplie des outils offerts par le droit français, l’article 145 cpc se distingue par sa capacité à ouvrir la voie à la preuve avant toute action judiciaire. Ce texte du code de procédure civile permet à toute partie de demander à un juge des mesures d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de préserver ou d’établir la preuve de faits susceptibles de peser lourd dans un futur litige. Autrement dit, il s’agit de ne pas attendre que le conflit soit officiellement lancé pour sécuriser les éléments déterminants.
Loin d’être réservé à une poignée d’initiés, ce mécanisme intéresse aussi bien les spécialistes du droit des affaires que ceux du droit pénal, du droit des sociétés ou du contentieux civil. On y a recours pour obtenir des documents, organiser des constats, auditionner des personnes. À Paris, la Civ veille scrupuleusement à l’existence d’un motif légitime : il faut convaincre le juge de l’utilité concrète et immédiate de la mesure sollicitée. À défaut, la demande sera écartée d’un revers de plume.
Pour bien cerner l’intérêt de cet article, voici les points majeurs à retenir :
- Preuve : pivot central pour défendre ses droits devant la justice
- Mesures d’instruction : expertise, constat, obtention de pièces
- Avocat : rôle déterminant dans la construction et la solidité de la demande
Ce qui fait la force de l’article 145 cpc, c’est sa flexibilité. Procédure sur requête, si la discrétion s’impose ; passage en référé, si l’urgence le commande. La justice française, par ce biais, encourage la préparation et la préservation des droits, bien avant que le contentieux ne soit tranché sur le fond. En somme, la preuve n’attend plus le coup d’envoi du procès pour surgir dans l’arène.
Exécution provisoire : ce qui a changé depuis le décret du 11 décembre 2019
Un basculement net s’est produit avec le décret du 11 décembre 2019 : l’exécution provisoire s’impose désormais comme principe, à moins que le juge n’en décide autrement par une motivation solide. Ce changement impacte de plein fouet les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 cpc et plus largement toute la procédure civile. Les conséquences sont immédiates pour tous les acteurs, du justiciable à l’avocat.
Jusqu’alors, il fallait solliciter expressément l’exécution provisoire, qui restait une exception accordée sous conditions. La logique s’est inversée : sauf décision motivée, toute décision de justice bénéficie d’emblée de l’exécution provisoire. Le juge peut la refuser uniquement si la nature de l’affaire ou le risque de conséquences manifestement disproportionnées l’impose.
Ce changement de paradigme entraîne plusieurs effets concrets :
- Possibilité pour les parties de voir une décision appliquée presque sans délai
- Renforcement de l’efficacité de la justice, qui ne s’enlise plus dans l’attente
- Pression accrue sur la partie perdante, contrainte d’exécuter avant même qu’un éventuel appel ne soit tranché
La cour de cassation surveille de près la motivation des juges lorsqu’ils écartent l’exécution provisoire. Cette vigilance est de mise dans tous les domaines : droit pénal, droit des affaires, ou procédures utilisant l’article 145 cpc. L’effet est double : la rapidité d’application devient un atout décisif, mais la tension monte d’un cran pour toutes les parties, qui doivent anticiper les conséquences de chaque décision.
Demande nouvelle et article 145 : quels apports du décret du 6 mai 2017 ?
Avec le décret du 6 mai 2017, la pratique de l’article 145 cpc s’est vue clarifiée sur la question de la demande nouvelle au cours de la procédure. Avant cette réforme, l’incertitude régnait : pouvait-on, après une ordonnance sur le fondement de l’article 145, formuler une nouvelle requête d’investigation ou ajouter une mesure sans risquer l’irrecevabilité ?
Désormais, la règle est posée. Toute demande nouvelle formulée en cours d’instance, qui poursuit un objectif distinct de la demande initiale, doit être examinée par le juge dans le respect du contradictoire et des droits de la défense. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation, mais le texte encadre plus strictement l’intervention des parties et de leurs avocats.
Impacts concrets sur la procédure civile
Les nouveautés introduites par ce décret se traduisent notamment par ces exigences :
- La partie qui saisit le juge doit prévoir dès l’origine la nature et l’étendue de ses demandes
- Le juge surveille de près que la demande nouvelle ne soit pas utilisée pour perturber la procédure ou déséquilibrer le procès
La jurisprudence récente, surtout à Paris, montre que les juges examinent avec attention la cohérence des mesures sollicitées. Dans les dossiers de droit des affaires et de droit des sociétés, l’utilisation de l’article 145 cpc obéit à des règles plus strictes : la rigueur procédurale s’impose à chaque étape. Ce décret a permis de mieux encadrer le recours à la preuve précontentieuse, tout en limitant les abus procéduraux.
Ce que ces évolutions impliquent concrètement pour les justiciables
Les changements encadrant l’article 145 cpc redessinent la façon d’aborder la preuve avant procès. Professionnels du droit et particuliers doivent composer avec des exigences nouvelles : chaque élément présenté devant le juge doit désormais être précisément identifié, motivé, pensé en amont. Les demandes vagues ou globales n’ont plus leur place. La justice réclame une argumentation solide à chaque étape.
Les avocats sont désormais amenés à revoir leur manière de conseiller. Préparer minutieusement le dossier, cibler la mesure la plus pertinente, anticiper les arguments contraires : l’article 145 cpc réclame une préparation sans faille, autant en droit des affaires qu’en droit pénal ou droit social. Ces derniers mois, les juridictions de Paris et Bordeaux ont montré une tolérance zéro pour les détournements de procédure ou les demandes motivées par la curiosité ou la volonté d’entraver la partie adverse.
Ce cadre renforcé concerne de nombreux profils :
- Salariés rassemblant des éléments pour établir un manquement à leur contrat de travail
- Entrepreneurs en phase de constitution ou de litige commercial
- Utilisateurs de réseaux sociaux cherchant à faire valoir leurs droits face à des propos diffamatoires
Dans tous les cas, il s’agit de s’entourer de conseils aguerris et méthodiques. La moindre imprécision, un argument oublié ou une demande mal structurée peuvent suffire à fermer la porte d’une issue favorable. Les professionnels du droit le savent : chaque détail compte, car la recherche de la vérité n’offre plus de place à l’approximation. Pour qui veut anticiper et sécuriser ses droits, l’article 145 cpc est plus que jamais un passage obligé, mais un passage surveillé, balisé, où la rigueur fait la différence.